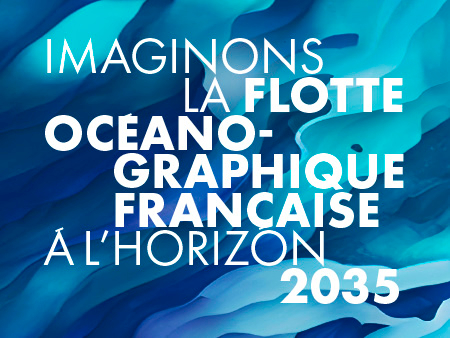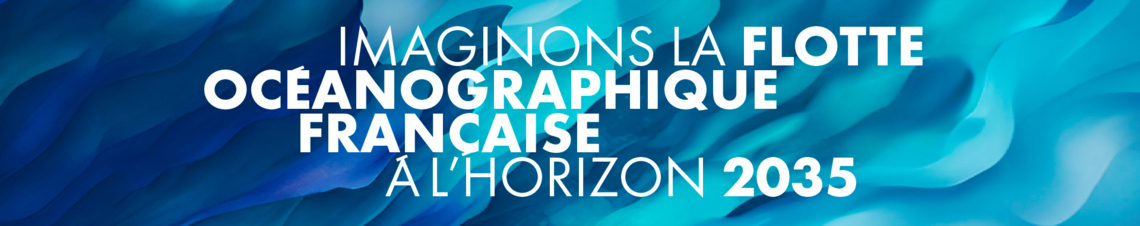Sezam, une campagne pilote
Au printemps 2024, durant la campagne Sezam, une expérience pilote de relevés des jauges de carburant a été menée à bord du Marion Dufresne. Ses objectifs étaient multiples : affiner les bilans gaz à effet de serre (GES) prévisionnels des futures campagnes océanographiques, identifier des leviers d’optimisation mais également sensibiliser les scientifiques embarqués.
Sédimentologue au sein de l'UMR Geo-Ocean de l’Ifremer, Estelle Leroux a activement participé à cette démarche. Elle en détaille les résultats et les enseignements.
Vous avez participé à la campagne Sezam, sur le navire océanographique Marion Dufresne au printemps 2024. Vous avez profité de cette mission dans le canal du Mozambique pour vous interroger sur son impact carbone. Pourriez-vous nous en dire plus ?
En effet, avec les deux co-chefs de mission de Sezam, Gwénaël Jouet et Marina Rabineau, nous avons souhaité avoir une idée plus précise des émissions de gaz à effet de serre de la campagne (bilan GES). Avant de partir, nous avons tenté d’établir un bilan prévisionnel basé sur une moyenne de la consommation journalière en carburant du Marion Dufresne, estimée à environ 22 m3 par jour en 2021. Nous avons également utilisé l’outil en ligne du collectif Labo 1.5 (GES Labo1point5) permettant d’estimer l’empreinte carbone de la mission en fonction du nombre de scientifiques embarqués, 33 en l’occurrence [1]. Nous avons ainsi obtenu deux estimations, a priori, de l’empreinte carbone de la campagne : 1539 tonnes équivalent CO2 à partir des données approximatives de consommation de carburant et 721 t eq. CO2 en considérant le bilan strictement relatif à notre laboratoire. Étant donné les incertitudes sur ces chiffres, nous avons souhaité quantifier précisément notre impact en nous basant sur des données réelles. D’où l’expérience pilote menée durant Sezam pour tester un protocole de relevés des jauges de carburant.
Quel a été le moteur de cette démarche ?
Aujourd’hui, l’impact des activités humaines sur le dérèglement climatique n’est plus à prouver. On sait également que les campagnes à la mer sont très émissives : elles représentent d’ailleurs plus de 50% des émissions GES annuelles au sein de notre UMR (d’après le bilan établi en 2022).
Face à ces constats, nous sommes de plus en plus de scientifiques à tenter d’être plus vertueux et à nous interroger sur la manière de réduire nos impacts, dans nos pratiques personnelles comme dans nos activités professionnelles. Pour cela, il faut identifier les leviers les plus efficaces.
« Cette expérience est donc née de nos sensibilités personnelles mais également de la volonté de s’appuyer sur des données quantifiées pour tester quelques leviers à l’échelle d’une campagne. Plus largement, cela s’inscrivait bien dans la réflexion globale entreprise au niveau de la Flotte océanographique française ».
Estelle Leroux
En quoi a consisté le protocole que vous avez mis en place durant la campagne ?
Nous avions défini un protocole de mesures de jauges avant le départ en mission et nous avons improvisé une fois à bord sur la manière de le mettre en pratique. Le commandant Ganor Ginat et l’Opexo[2] Nicolas Pensiot se sont montrés motivés par notre démarche. Pour des raisons de sécurité, nous, scientifiques, n’avons pas pu avoir accès directement aux mesures de jauges de carburant. C'est donc l’équipe machine, sur ordre du commandant, qui a effectué des relevés réguliers tout au long de la mission.
Nous avons récupéré les relevés de consommation de carburant pour chacun des trois moteurs, au début et à la fin de chaque opération scientifique. Nous avions défini trois types d’opérations en distinguant les phases de transits vers la zone d’étude et entre les opérations, les phases d’acquisitions sismiques et les phases de stations de carottages.
En parallèle, nous avions décidé, collégialement, d’abaisser nos vitesses de transit à dix voire huit nœuds en tentant de se limiter à l’utilisation au meilleur rendement d’un seul moteur, quitte à être plus que raisonnable sur le nombre d'acquisitions réalisées. Il y a toujours des aléas à bord et des modifications quotidiennes du plan des opérations. Nous avons donc aussi essayé d’optimiser en temps réel les positions et le déroulé des opérations afin de minimiser les distances parcourues, quand cela était possible.
Les relevés de jauges ont ensuite été croisés aux données des différents cahiers de quart, pour analyser les évolutions simultanées des consommations en carburant, des vitesses du navire, des motorisations et des états de mer. Cette synthèse a nécessité de trier et récupérer chacune des observations manuscrites des cahiers, elle s’est donc avérée très chronophage.
Quels résultats avez-vous observés ?
Grâce aux relevés de jauges, nous avons pu obtenir la consommation totale de carburant : 294 085L pour une mission de 24 jours. À titre de comparaison, cela représente environ 5 millions de kilomètres parcourus par une voiture qui consomme 6L/100km.
Ce qui nous a le plus surpris, c’est la consommation moyenne journalière, comprise entre 12 et 13 m3 par jour, un chiffre bien inférieur aux 22 m3/jour que nous avions estimés avant le départ. Même si nos prévisions étaient probablement surestimées, on peut considérer que les efforts que nous avons fournis, comme la réduction des vitesses de transit et l’utilisation « raisonnée » des moteurs, n’ont pas été vains.
Quels enseignements tirez-vous de cette expérimentation ?
Nous avons pu confirmer la relation directe entre la réduction de consommation de carburant et les limitations imposées pendant la campagne dans l’utilisation des moteurs. Ces données seront très utiles pour élaborer des bilans GES prévisionnels beaucoup plus précis sur des futures campagnes programmées sur le Marion Dufresne.
L’impact de nos choix d’optimisation reste difficile à quantifier. Mais nous avons quand même identifié des leviers efficaces. Le bilan est donc positif ! Il serait intéressant à présent de mener ce type d’expérience sur les autres navires de la Flotte océanographique française, en optimisant la démarche. Pour cela, l’automatisation des relevés de jauges et de l’ensemble des observations à bord serait idéale.
Un autre enseignement intéressant à souligner est l’adéquation entre le bilan GES que nous avons établi et celui estimé par la méthode GES1point5 pour quantifier l’impact des campagnes océanographiques au sein des laboratoires de recherche.
Enfin, l’une des vertus principales de cette expérience aura été la sensibilisation des scientifiques embarqués mais également des neuf étudiants de Master de Brest et de Montpellier présents à bord. La question de l’empreinte environnementale les a particulièrement intéressés. C’est même l’un des sujets qu’ils abordent dans le film documentaire qu’ils ont réalisé après la campagne.
[1]En février 2025, la Flotte océanographique française, la cellule RSE de l’Ifremer et le GdR Labo1.5 ont repris contact dans la perspective d’améliorer cet outil en ligne et d’y intégrer les estimations les plus récentes de consommation de carburant des navires de la FOF.
[2] L’Opexo assure le rôle d’interface principale entre l’équipe scientifique et l’équipage du navire.